Infections sexuellement transmissibles : de nouvelles recommandations dans la prise en charge
Herpès génital, condylomes anogénitaux, trichomonase et pthirose, ces infections sexuellement transmissibles virales et parasitaires, ont fait l’objet de nouvelles recommandations de la part des agences de santé. Focus sur ces nouvelles prises en charge dont l’objectif est bien évidemment d’améliorer l’efficacité des soins.
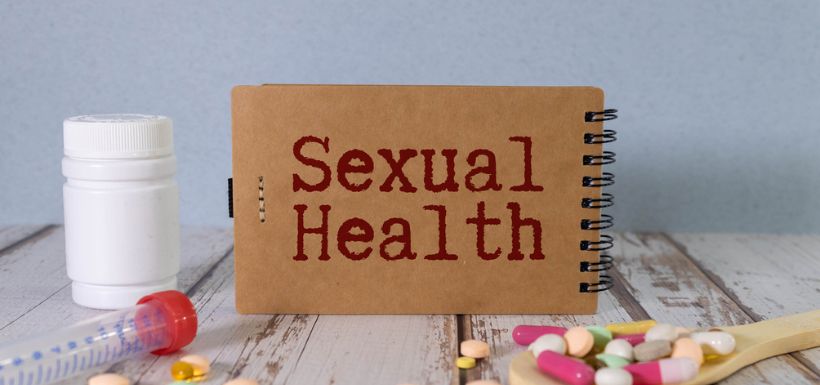
Quelles sont les 4 IST concernées ?
L’ANRS-Maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE), la Haute Autorité de santé (HAS) et le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) ont mis à jour les recommandations de prise en charge de quatre infections sexuellement transmissibles (IST) virales et parasitaires.
L’herpès génital est st une maladie virale très contagieuse et sexuellement transmissible. Après la primo-infection, le virus s’installe dans l’organisme et s’y « endort ». Il se manifeste ensuite, par de petites cloques évoluant en plaies, localisées sur les organes sexuels ou à proximité.
Les condylomes anogénitaux correspondent à une infection due à certaines souches de virus, les Papillomavirus humains. Cette infection prend la forme d’une verrue, qui affecte principalement les parties génitales des hommes et des femmes, et plus rarement la région anale.
Latrichomonase est une IST touchant les hommes comme les femmes. Elle est provoquée par la présence de Trichomonas vaginalis qui est un parasite transmis le plus souvent par contact sexuel. L’infection peut être asymptomatique ou se manifester sous forme d’urétrite, de vaginite, de cystite, d’épididymite ou de prostatite.
La pthirose ou pédiculose pubienne est une ectoparasitose due à̀ Pthirus inguinalis/pubis plus communément appelé pou du pubis ou morpion. Sa prévalence mondiale est estimée entre 1,3% et 4,6%.
Trichomonase et pthirose : nouvelles recommandations
Les recommandations sur le traitement de la trichomonase concernent la posologie du métronidazole.
A la place de la dose unique, le patient bénéficiera de deux prises quotidiennes de 500 mg durant 7 jours, et passées à 1 g en cas de résistance au principe actif du médicament. Si le traitement initial échoue, il est répété. Pour un patient allergique, des alternatives locales (ovules, crèmes) ou une désensibilisation seront proposées.
Dans la pthirose, et après le rasage et le retrait manuel des lentes et des adultes, les traitements topiques (médicaments appliqués directement sur la peau) sont indiqués pour les formes localisées et chez les femmes enceintes. Les traitements sont à base de perméthrine crème 5 % ou de diméticone en lotion. En deuxième ligne, la classe thérapeutique sera modifiée.
Aussi, pour éviter l’émergence de résistances, le recours à l’ivermectine sera envisagé, dans des situations bien précises. Par exemple, dans la forme abondante dite forme profuse et en troisième ligne en cas d’échec.
Condylome : un équilibre entre ablation et applications topiques
Deux types de traitement des condylomes anogénitaux existent : ablatifs (faible nombre de condylomes espacés) avec la cryothérapie et topiques (grand nombre de condylomes ou condylomes rapprochés) avec la podophyllotoxine 0,5 % et l’imiquimod. Le médecin pourra utiliser ces deux méthodes individuellement ou associées en fonction du diagnostic.
S’il y a une résistance au traitement, les alternatives sont nombreuses. Il peut s’agir du recours à l’électrochirurgie, au laser CO2, à la photothérapie dynamique ou à d’autres molécules (acide trichloracétique, 5-fluorouracile (5FU) et hydroxyde de potassium).
En cas de grossesse, les recommandations suggèrent l’abstention thérapeutique en l’absence de gêne pour l’accouchement. En cas de gène, il faudra privilégier les traitements ablatifs.
Un algorithme pour mieux traiter l’herpès
Pour la prise en charge de l’herpès génital, un algorithme décisionnel permet de croiser les données diagnostic (sévérite ou non de la primo-infection, récurrence de l’infection), avec le profil du patient (immunodéprimé ou non et femme enceinte).
La primo-infection bénigne est traitée par valaciclovir et l’aciclovir par voie orale est recommandé en deuxième intention. Si l’infection est sévère, l’aciclovir est administré par voie intraveineuse. Les experts citent des alternatives topiques comme l’aloé véra 0,5 % et l’imiquimod 1 % (avec nécessité de procéder à une dilution par les préparateurs en pharmacie).
Si l’infection récidive, le traitement peut être curatif (à prendre dans les deux jours après le début des symptômes) ou en prévention, selon son retentissement sur la vie quotidienne.
Pour les patients immunocompétents et patients VIH avec un taux de CD4 supérieur à 200 mm3, il est recommandé du valaciclovir deux fois 2 g sur un jour. Pour les patients immunodéprimés sévères, le dosage est de 1 g deux fois par jour pendant au moins 5 jours et jusqu’à guérison complète des lésions. En cas de résistance aux antiviraux, le foscarnet par voie intraveineuse est à privilégier, le cidofovir intraveineux est à donner en deuxième intention.
En prévention, il est recommandé une prise de valaciclovir 500 mg une fois par jour (l’aciclovir 400 deux fois par jour étant en deuxième intention) pendant 6 à 12 mois. Les patients immunodéprimés recevront indifféremment de l’aciclovir 400 mg deux fois par jour ou du valaciclovir 500 mg deux fois par jour. Chez la femme enceinte, le traitement préventif permettant de diminuer la probabilité du recours à la césarienne est administré dès la 36ème semaine.
Cet article vous a-t-il été utile ?